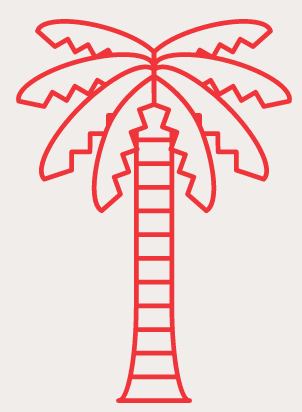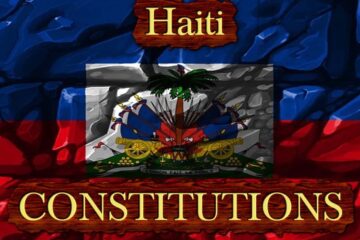Plus d’un siècle après l’occupation américaine de 1915, les États-Unis tentent à nouveau de jouer les arbitres dans la crise haïtienne. Le secrétaire d’État Marco Rubio a récemment pressé l’Organisation des États américains (OEA) de prendre la tête d’une mission multinationale, censée aider à restaurer la sécurité et l’ordre dans un pays en plein effondrement. Mais cette annonce, qui survient après l’échec cuisant de la mission dirigée par le Kenya, suscite de lourdes interrogations : peut-on vraiment espérer une solution durable imposée de l’extérieur ? Ou Haïti est-elle condamnée à rejouer le même scénario, encore et encore, sans jamais écrire le sien ?
Un siècle de recettes étrangères, pour quel résultat ?
Depuis l’intervention américaine de 1915 jusqu’aux initiatives les plus récentes soutenues par l’ONU, la France, le Canada ou la CARICOM, Haïti a rarement été maître de son propre destin politique. La mise en place du Conseil présidentiel de transition (CPT), sous l’impulsion de puissances étrangères, s’inscrivait dans cette logique. Pourtant, plusieurs mois après sa création, le bilan est sans appel : l’insécurité règne, les institutions restent paralysées, et la confiance populaire est absente.
« Une transition sous supervision étrangère n’a jamais produit autre chose qu’un vide de leadership et une aggravation des crises », souligne un journaliste haïtien, Amoureux de la sagesse. Il ajoute : « La solution pour Haïti ne peut pas venir de Washington, d’Ottawa ou de Paris. Elle doit venir de chez nous. »
L’OEA comme dernier recours ?
L’appel lancé par Marco Rubio à l’OEA pour qu’elle prenne la tête d’une nouvelle mission internationale soulève de nombreuses interrogations dans la société haïtienne. L’Organisation des États américains, souvent perçue comme un relais des intérêts nord-américains, peut-elle réellement jouer un rôle neutre et efficace dans une telle situation ?
Le souvenir amer des précédentes interventions — souvent accompagnées de promesses non tenues et de scandales de corruption ou d’abus — alimente un scepticisme largement partagé dans l’opinion publique. Pour beaucoup, il ne s’agit que d’un nouvel emballage pour une vieille stratégie : contrôler sans réellement comprendre, stabiliser sans reconstruire.
Une crise enracinée dans l’âme du pays
Plusieurs voix critiques s’élèvent pour rappeler que la crise haïtienne ne peut être réduite à une simple question de sécurité ou de gouvernance. Elle est aussi sociale, culturelle, éducative, et spirituelle.
« Tant qu’on n’aura pas une éducation adaptée à la réalité haïtienne, qui enseigne aux enfants à aimer leur pays, à connaître leur histoire et à se projeter dans un avenir collectif, rien ne changera vraiment », insiste le professeur de philosophie, Amoureux de la sagesse. « Tant que la bourgeoisie haïtienne manipulera la politique pour défendre ses privilèges au détriment du peuple, aucune réforme ne tiendra debout. »
Pour d’autres, la solution va au-delà du politique et du technique. Elle touche à une dimension spirituelle, une capacité collective à se réconcilier avec soi-même, à retrouver une forme d’éthique publique, voire une « connaissance divine », selon l’expression utilisée dans plusieurs mouvements citoyens. Sans cela, préviennent-ils, « le peuple haïtien restera prisonnier d’un enfer sans fin ».
Entre dépendance et autonomie, un choix historique
À l’heure où les grandes puissances s’agitent pour « sauver Haïti » à leur manière, la question reste entière : les Haïtiens auront-ils un jour l’espace et les moyens de penser et construire leur propre solution ? Ou seront-ils condamnés à subir les visions extérieures, déconnectées de leurs besoins réels ?
Une certitude semble se dégager dans la confusion ambiante : la paix durable ne se décrète pas de l’extérieur. Elle se construit, patiemment, depuis le terrain, avec les acteurs locaux, les communautés, les enseignants, les paysans, les jeunes, les croyants — avec tous ceux qui n’ont jamais été invités à la table des décisions, mais qui vivent chaque jour les conséquences de leur absence.