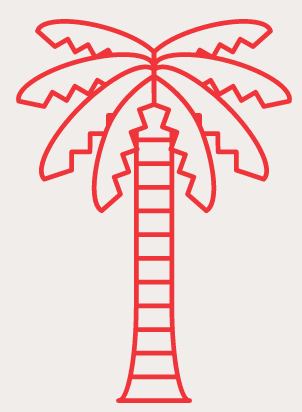Comment violence, corruption et abandon international ont plongé le pays dans le chaos
L’histoire des gangs en Haïti remonte à plusieurs décennies et est étroitement liée aux dynamiques politiques, économiques et sociales du pays. Voici une chronologie des principaux événements qui ont conduit à la situation actuelle :
1. Période de la dictature des Duvalier (1957-1986) : La naissance des milices armées
- François Duvalier (“Papa Doc”), président à partir de 1957, crée une milice paramilitaire appelée les Tontons Macoutes (officiellement les Volontaires de la Sécurité Nationale, VSN) pour réprimer toute opposition.
- Cette milice, composée de civils armés et fidèles au régime, sème la terreur, assassine et persécute les opposants politiques.
- Après la mort de François Duvalier en 1971, son fils Jean-Claude Duvalier (“Baby Doc”) maintient ces forces paramilitaires.
- En 1986, face à la révolte populaire et à la pression internationale, Baby Doc est contraint à l’exil. Mais les anciens Tontons Macoutes ne disparaissent pas totalement et certains se reconvertissent dans des activités criminelles.
2. La période post-Duvalier (1986-2004) : Déstabilisation et émergence des gangs
Dès les années 1990, des élites politiques ont instrumentalisé les gangs pour asseoir leur pouvoir. Sous Jean-Bertrand Aristide (1991–2004), des groupes comme les Chimères terrorisaient l’opposition.
- Avec la chute du régime Duvalier en 1986, l’armée haïtienne (FAd’H) prend le contrôle du pays, mais elle est contestée par des mouvements démocratiques.
- Dans les années 1990, avec l’élection de Jean-Bertrand Aristide (1990), une nouvelle dynamique de violence apparaît. Aristide, un ancien prêtre populaire, tente de démanteler les structures de l’ancien régime.
- En 1991, un coup d’État militaire le renverse et les forces armées répriment violemment ses partisans.
- En 1994, Aristide est rétabli au pouvoir avec le soutien des États-Unis et dissout l’armée haïtienne (FAd’H) en 1995, mais cela crée un vide sécuritaire.
- Pour compenser la dissolution de l’armée, des groupes armés de quartier, appelés “Chimeres” (milices loyales à Aristide), commencent à émerger.
- En 2004, Aristide est de nouveau chassé du pouvoir après une rébellion armée menée par d’anciens militaires et des gangs criminels.
3. L’explosion des gangs après 2004
- Après la chute d’Aristide, les gangs deviennent plus autonomes et incontrôlables. Certains groupes, initialement liés aux politiciens, commencent à agir de manière indépendante.
- La Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) est déployée pour tenter de contenir la violence, mais les gangs trouvent des sources de financement grâce au trafic de drogue, aux enlèvements et aux extorsions.
- Le tremblement de terre de 2010 affaiblit encore plus l’État, et de nombreux gangs profitent du chaos pour étendre leur influence.
4. La montée des gangs modernes (2010 – aujourd’hui): Gangs 2.0
- À partir des années 2010, les gangs deviennent des structures bien organisées, avec des chefs influents comme “Barbecue” (Jimmy Chérizier), ancien policier devenu chef de la “Fédération G9”, un regroupement de gangs.
- Les gangs contrôlent des territoires entiers, notamment à Port-au-Prince, et commencent à imposer des taxes sur les populations locales.
- Les politiciens et les hommes d’affaires commencent à financer certains gangs pour leur protection ou pour influencer les élections.
- Depuis 2020-2024, les enlèvements de masse et le trafic d’armes explosent, avec des armes venant principalement des États-Unis via la contrebande.
5. Situation actuelle : un État presque capturé
- Aujourd’hui, Haïti est en proie à une crise sans précédent, où les gangs remplacent presque l’État dans certaines régions.
- Ils contrôlent les routes, les ports et même certaines institutions publiques.
- Le gouvernement est impuissant et dépend souvent des négociations avec les chefs de gangs pour maintenir un semblant de stabilité.
- Les sanctions internationales ont récemment visé certains politiciens et hommes d’affaires accusés de financer les gangs, notamment Michel Martelly.
Solutions : entre espoirs et défis
- Désarmer les gangs : Une tâche titanesque sans coopération régionale contre le trafic d’armes.
- Juger les commanditaires : Les États-Unis ont sanctionné des sénateurs et oligarques, mais les procès en Haïti sont rares.
- Reconstruire l’État : Sans élections depuis 2016, la légitimité des institutions est nulle.
Conclusion
La montée des gangs en Haïti est un phénomène complexe et multifactoriel, impliquant des dynamiques politiques, la corruption, la pauvreté et le trafic de drogue. Ce n’est pas seulement un problème de criminalité, mais une véritable crise de gouvernance, où les gangs ont su exploiter le vide laissé par un État affaibli.
« Si on ne s’attaque pas à la racine – la corruption et la pauvreté –, les gangs resteront les rois d’Haïti », conclut Jean-Claude Pierre.
Et si la situation continue ainsi, Haïti risque de devenir un État entièrement sous le contrôle des gangs, avec des implications régionales et internationales majeures.