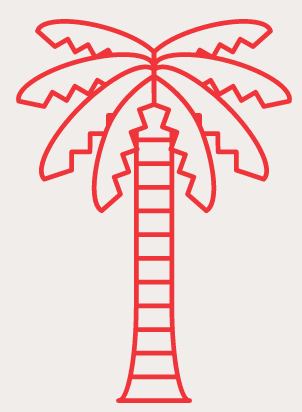Leur silence résonne comme un vide assourdissant dans un pays où les voix fortes se font rares, où la peur règne, et où les puissants préfèrent se terrer dans l’ombre quand le chaos qu’ils ont aidé à construire les dépasse. Depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, Réginald Boulos et Dimitri Vorbe, deux figures majeures de la bourgeoisie haïtienne, sont devenus presque invisibles, alors qu’ils avaient été omniprésents, influents, parfois même provocateurs dans la vie publique, économique et politique du pays.
Pourquoi ce silence soudain ? Que cachent ces absences prolongées dans une période où les responsabilités doivent être clarifiées et les comptes, rendus ?
Des hommes d’affaires devenus acteurs politiques de l’ombre
Avant la mort brutale de Jovenel Moïse, Réginald Boulos et Dimitri Vorbe n’étaient pas que des entrepreneurs. Ils étaient aussi devenus, à des degrés divers, des figures de l’opposition active. Le premier, Boulos, ancien médecin et magnat des affaires, avait amorcé une transformation publique en prétendant à une carrière politique. Il finançait ouvertement des mobilisations, créait des plateformes, et multipliait les déclarations contre le pouvoir en place.
Le second, Vorbe, PDG de SOGENER, s’était heurté frontalement à Jovenel Moïse autour des contrats énergétiques controversés. Ce bras de fer s’était soldé par une série de poursuites judiciaires, un mandat d’amener, puis son exil à l’étranger. Mais même à distance, Vorbe continuait de peser dans les rapports de force, souvent à travers des canaux de communication bien huilés.
Pourtant, après l’assassinat du président, les deux se sont tus. Plus de communiqués, plus d’interventions médiatiques, plus d’analyses, plus de critiques. Leurs réseaux sociaux sont devenus muets. Leurs organisations politiques ont disparu du paysage.
Des liens troubles avec des groupes armés ?
Ce mutisme est d’autant plus troublant que plusieurs rapports, témoignages et enquêtes informelles évoquent depuis des années les financements occultes qui ont alimenté les mouvements de rue, souvent violents, entre 2018 et 2021. Sous couvert de soutien à la “mobilisation populaire”, certains de ces financements auraient servi à équiper des groupes armés. Parmi eux, des figures devenues tristement célèbres comme Ti Ougan ou Krisla, des chefs de gangs désormais impliqués dans les pires dérives sécuritaires que connaît Port-au-Prince aujourd’hui.
Le flou est volontaire. Les frontières entre activisme communautaire, réseaux de gangs, clientélisme politique et stratégie économique sont volontairement brouillées. Mais une chose est certaine : plusieurs personnalités du secteur privé ont, à un moment ou un autre, alimenté ce système dans l’espoir de faire tomber un pouvoir devenu encombrant pour leurs intérêts.
Pourquoi leurs entreprises restent intouchables ?
Dans une ville livrée à l’anarchie, où les marchés sont brûlés, les écoles saccagées, les centres hospitaliers pillés, certaines entreprises, en particulier celles associées à Réginald Boulos, semblent épargnées. Pas un pillage, pas une attaque, pas une menace publique.
Simple hasard ? Protection négociée ? Entente tacite ? Plusieurs analystes s’interrogent sur la nature de cette immunité. Et surtout, sur ce qu’elle révèle du rapport entre les élites économiques et les acteurs de violence. Dans un pays où le pouvoir ne réside plus dans les institutions, mais dans les armes, il est légitime de se demander qui protège qui, et pourquoi.
Une bourgeoisie silencieuse, mais coupable ?
La question dépasse les seuls cas de Boulos et Vorbe. Elle touche à un problème structurel : la responsabilité de la bourgeoisie haïtienne dans la faillite de l’État. Depuis des décennies, une partie de cette élite économique a préféré pactiser avec les pouvoirs successifs ou tirer profit de leur faiblesse, plutôt que de contribuer à bâtir un État fort, équitable et moderne.
Elle s’est contentée de zones de confort, de monopoles bien gardés, de marchés publics sans concurrence, de l’évitement fiscal, d’une paix négociée dans certains quartiers, pendant que le reste du pays s’effondrait.
Et aujourd’hui, alors que le chaos est total, elle se tait.
Derrière le silence : l’attente d’une prochaine transition ?
Le plus inquiétant n’est pas seulement leur absence médiatique, mais ce qu’elle pourrait annoncer. Car si ces acteurs attendent dans l’ombre, ce n’est peut-être pas par peur, mais par stratégie. Ils savent que le Conseil Présidentiel de Transition, déjà en perte de crédibilité, ne tiendra probablement pas jusqu’en 2026. Et comme dans chaque crise haïtienne, ceux qui ont les moyens de l’influence savent patienter… pour mieux apparaître au moment opportun.
Si l’histoire se répète, on verra sans doute surgir de nouveaux discours patriotiques, de nouveaux plans de sauvetage national, de nouvelles promesses d’engagement citoyen, portés par les mêmes figures, recyclées, lavées de leur passé, prêtes à “reconstruire” ce qu’elles ont contribué à détruire.
La vérité attend encore
Haïti ne guérira pas sans vérité. La vérité sur l’assassinat du président. La vérité sur les financements politiques des années de chaos. La vérité sur les alliances entre milieux d’affaires et groupes armés. Le silence de Boulos et Vorbe, dans ce contexte, est plus qu’un choix personnel. Il devient un symptôme, une alerte, un indice.
Tant que les élites ne seront pas appelées à rendre des comptes, il n’y aura pas de reconstruction possible. Ni paix. Ni stabilité. Seulement des transitions en chaîne, des promesses sans lendemain, et un peuple toujours plus seul face à sa douleur.