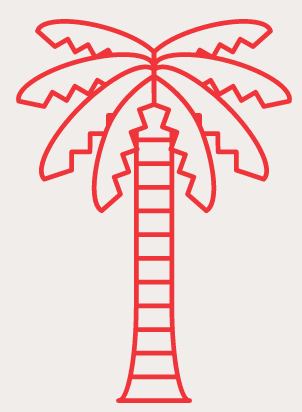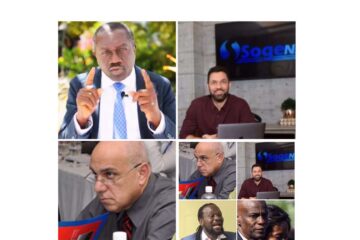Port-au-Prince, avril 2025 — Dans les ruelles étroites de Cité Soleil, à Bel Air, à Croix-des-Bouquets, l’écho des rafales d’armes automatiques a depuis longtemps remplacé les rires des enfants. Le pays est pris en otage. Pas seulement par des gangs lourdement armés, mais aussi par un système politique à bout de souffle, incapable de protéger, de réformer, ou même d’exister véritablement. Au cœur de cette débâcle, le Conseil Présidentiel de Transition (CPT), installé dans l’urgence comme une planche de salut, incarne désormais l’échec d’un État à se réinventer.
Un Conseil pour rien ?
Lors de sa création, le CPT portait la promesse d’une sortie de crise. L’espoir, certes timide, d’un retour progressif à l’ordre républicain. Quelques mois plus tard, ce qui devait être une parenthèse de transition ressemble de plus en plus à un cercle vicieux. Le Conseil s’est enfoncé dans les mêmes logiques politiciennes que celles qui ont ruiné la confiance populaire depuis des décennies : querelles de pouvoir, absence de transparence, népotisme, immobilisme. Rien n’a été fait pour freiner l’expansion des groupes armés. Rien pour relancer l’économie. Rien pour rassurer une population à bout.
Pendant ce temps, les gangs avancent
Dans l’ombre du CPT, les gangs, eux, ne perdent pas de temps. Ils gagnent du terrain, consolidant leur contrôle sur des quartiers entiers, imposant leur loi, défiant l’autorité avec une aisance presque cynique. L’État est absent, ou complice, ou tétanisé — personne ne sait vraiment. Ce qui est sûr, c’est que les armes parlent plus fort que les décrets, et que les chefs de gangs sont, aux yeux de beaucoup, plus puissants que les figures politiques elles-mêmes. Port-au-Prince n’est plus une capitale : c’est un champ de bataille fragmenté, une zone grise où survivent ceux qui peuvent fuir ou se soumettre.
Une élite de transition… bien installée
Dans ce chaos, les membres du CPT semblent vivre dans une bulle hermétique, déconnectée des réalités du terrain. Pendant que le peuple s’effondre sous le poids de la faim, de la peur et de l’exode, eux s’installent, négocient, manœuvrent. On parle déjà de renouvellement de mandats, de postes stratégiques à conserver, de nominations futures. La transition est devenue un confort politique. Elle ne sert plus à rétablir l’ordre, mais à maintenir un statu quo utile à ceux qui tirent les ficelles. Haïti devient un pays de transitions à répétition, jamais abouties, toujours promises, rarement sincères.
Une souffrance sans fin
Chaque jour qui passe prolonge l’agonie du peuple haïtien. Les hôpitaux ferment, les écoles désertent, les marchés brûlent, les rues pleurent. L’espoir s’amenuise. Les voix critiques sont réduites au silence ou contraintes à l’exil. La jeunesse — cette jeunesse qui rêvait d’une autre Haïti — prend les bateaux de fortune, traverse les frontières, fuit. Ceux qui restent n’ont plus que la foi, ou l’oubli.
Vers un effondrement irréversible ?
La question n’est plus de savoir si la transition va réussir, mais si Haïti peut encore éviter l’effondrement total. Une nation peut-elle survivre sans institutions fonctionnelles ? Sans territoire contrôlé ? Sans projet collectif ? La réponse est incertaine. Certains observateurs parlent d’un “État en suspension”, ni mort ni vivant, où les symboles républicains tiennent lieu de façade. D’autres évoquent une reconstruction possible, mais au prix d’une rupture radicale avec les acteurs actuels. Il faudrait tout réinventer : le système politique, les règles du jeu, le lien avec la population.
Haïti peut-elle encore respirer ?
Dans cette nuit sans fin, reste une question : Haïti peut-elle encore respirer ? Peut-elle sortir la tête de l’eau, relever la nuque, se réapproprier son destin ? La réponse ne viendra pas du CPT, ni des chancelleries étrangères, ni même d’un miracle. Elle viendra — si elle vient — d’un sursaut collectif, d’un réveil douloureux mais nécessaire, où ceux qui aiment ce pays décideront enfin de le reconstruire, non pas pour le pouvoir, mais pour la vie.