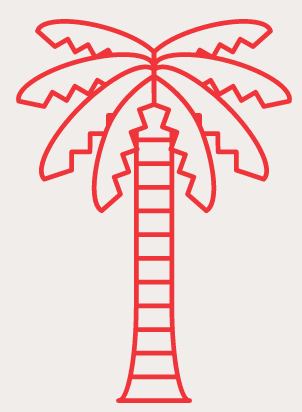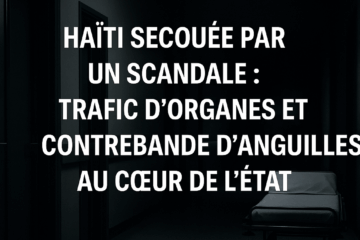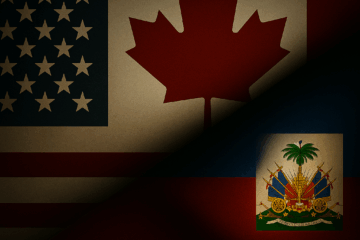En moins de deux ans, deux figures emblématiques de l’ancien parti Fanmi Lavalas ont été propulsées à la tête du Conseil Présidentiel de Transition (CPT) : d’abord l’urbaniste Leslie Voltaire, puis l’économiste Fritz Jean. Pourtant, loin d’incarner une rupture ou une relance pour Haïti, leur passage semble avoir confirmé une désillusion persistante : la classe politique traditionnelle, malgré ses diplômes et décennies d’expérience, est aujourd’hui perçue comme incapable de répondre aux urgences du pays.
Un bilan qui parle de lui-même
Dans les rues de Port-au-Prince comme dans les provinces, le constat est amer : incompétence, immobilisme, et déconnexion avec la réalité quotidienne. Les discours éloquents et les promesses de réformes profondes se sont heurtés à une absence criante d’actions concrètes. Aucun plan solide contre l’insécurité endémique. Aucune mesure d’envergure pour endiguer la misère, l’exode des jeunes, ou le chômage massif.
Alors que la population vit dans la peur constante des gangs, et que les prix des denrées flambent, les membres du CPT semblent davantage préoccupés par les tournées diplomatiques que par la gouvernance réelle. Plusieurs observateurs dénoncent une dilapidation des fonds publics, sous couvert de missions internationales « sans résultats tangibles ».
Le pouvoir comme rente
Au-delà de l’inaction, des accusations plus graves émergent. Des voix au sein de la société civile pointent du doigt un système où l’État devient une rente, un levier d’enrichissement personnel au détriment du bien commun. Voyages officiels coûteux, détournement présumé de fonds, népotisme rampant — le tout dans un contexte d’absence totale de transparence.
Plus troublant encore, des allégations persistantes évoquent des comportements éthiquement répréhensibles : relations entretenues avec des adolescentes, clientélisme sexuel, et train de vie ostentatoire, en total décalage avec la réalité du peuple haïtien. Pendant que la majorité survit avec moins de deux dollars par jour, certains dirigeants envoient leurs enfants étudier à l’étranger, bien loin du chaos qu’ils contribuent à entretenir.
La faillite d’un modèle
Ces deux mandats successifs incarnés par des figures historiques du mouvement Lavalas mettent en évidence une crise de leadership systémique. Ce n’est plus seulement une question de personnes, mais d’un modèle entier : celui d’une élite politique incapable de se renouveler, de se réformer, et surtout, de faire face aux défis contemporains.
Haïti ne manque pas d’intelligences, ni de compétences. Mais elles sont souvent exclues du cercle fermé du pouvoir, ou poussées à l’exil. Pendant ce temps, la vieille garde recycle les mêmes visages, les mêmes promesses, et les mêmes échecs.
Quelle alternative pour le pays ?
Aujourd’hui, une question centrale se pose : la transition est-elle encore possible avec les acteurs traditionnels ? Pour beaucoup, la réponse est non. Une génération entière réclame un changement radical de méthode, de vision, et d’hommes.
Ce qui est en jeu, ce n’est plus seulement la survie institutionnelle, mais la dignité même d’un peuple fatigué de l’humiliation, de l’abandon, et du mépris. Haïti n’a pas besoin d’un nouveau slogan, ni d’un autre discours technocratique. Le pays a besoin d’action, de courage politique, et surtout de justice sociale.