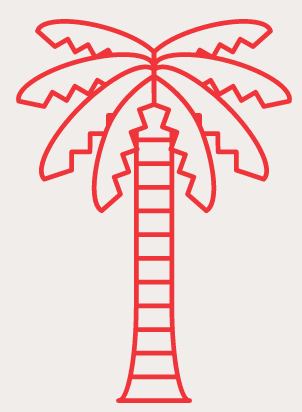La Police Nationale d’Haïti (PNH), censée incarner l’ordre, la sécurité et la stabilité dans un pays fragilisé, semble aujourd’hui gangrenée par une crise profonde. Une crise d’identité, de légitimité et de fonctionnement. De plus en plus de voix, y compris d’anciens responsables de haut niveau, dénoncent une institution infiltrée, corrompue, et, pour certains, irrécupérable.
Parmi les déclarations les plus marquantes, celles de l’ancien Premier ministre Gary Conille résonnent comme un véritable cri d’alarme. Dans une lettre adressée à son père – dont le contenu a fuité récemment – Conille affirme avoir échappé à plusieurs tentatives d’assassinat grâce à des informations de dernière minute. Plus troublant encore, il y révèle que des policiers affectés à sa sécurité entretenaient des liens directs avec des gangs armés. Une affirmation grave, mais qui semble corroborée par plusieurs autres témoignages et enquêtes journalistiques indépendantes.
Une institution infiltrée et instrumentalisée
Les révélations selon lesquelles près de la moitié des agents de la PNH seraient en lien avec des groupes criminels – ou en seraient directement membres – jettent une lumière crue sur les failles du processus de recrutement et de formation. De nombreux agents auraient intégré la police sans formation académique digne de ce nom, grâce à des recommandations politiques de ministres, sénateurs, députés ou autres figures d’influence. Résultat : une institution qui, au lieu d’assurer la sécurité publique, devient parfois complice ou actrice des violences qu’elle est censée combattre.
Les dérives vont au-delà des simples connivences : certains policiers sont accusés de vols, d’agressions, voire d’assassinats. Cette réalité, bien que difficile à quantifier précisément, alimente un sentiment de méfiance et d’indignation croissante au sein de la population.
L’incident du Cap-Haïtien : un symbole du désastre
Le 18 mai dernier, au Cap-Haïtien, une scène choquante a ravivé l’indignation populaire : alors que des professeurs manifestaient pacifiquement pour demander des revalorisations salariales, des policiers ont violemment réprimé la mobilisation. Une enseignante a été frappée au visage, au point que ses yeux ont été inondés de sang. Cette image, partagée massivement sur les réseaux sociaux, a bouleversé le pays.
Comment expliquer un tel niveau de brutalité contre des professionnels de l’éducation venus simplement réclamer leurs droits ? L’absence de formation, de principes déontologiques, de respect des droits humains, ou simplement d’humanité, semble être au cœur du problème.
« Dans un pays comme Haïti, où le professeur résiste malgré tout pour continuer à éduquer, il devrait être considéré comme un héros, pas comme une cible », réagit une responsable syndicale du Nord.
Quelle issue pour la PNH ? Réforme ou remplacement ?
Face à ce tableau sombre, plusieurs analystes et membres de la société civile appellent à une réforme radicale, voire à une dissolution pure et simple de la PNH. Certains évoquent la possibilité de transférer les missions de sécurité à une armée réformée, ou de créer une nouvelle génération de forces de l’ordre fondée sur des critères stricts de formation, d’éthique et de compétence.
Mais cela suffira-t-il ? Les racines du mal semblent profondes, ancrées dans une culture d’impunité, de clientélisme politique et d’effondrement institutionnel.
Le professeur, dans ce contexte, devient plus qu’un simple éducateur : il incarne l’espoir d’un avenir meilleur. Tandis que les membres du Conseil Présidentiel de Transition (CPT), eux, sont perçus par une large partie de la population comme des figures de blocage, plus préoccupées par leurs intérêts que par le bien commun.
« Un professeur forme la nation. Un politicien peut la détruire », disait récemment un étudiant à Port-au-Prince, après avoir vu la vidéo de l’enseignante agressée.
Une refondation indispensable
Haïti ne pourra espérer de stabilité durable tant que ses institutions, notamment celles chargées d’assurer la sécurité, resteront gangrenées de l’intérieur. La réforme de la PNH ne peut plus être un simple discours politique. Elle doit devenir une priorité nationale.
Sans cela, la spirale de la violence continuera, et avec elle, la perte de confiance des citoyens dans un État déjà en lambeaux.