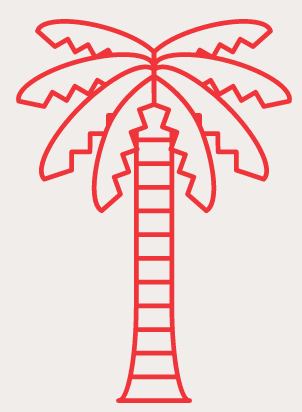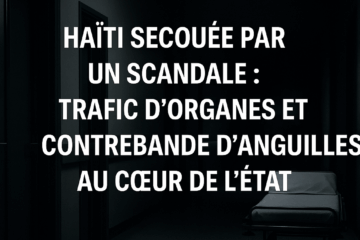Par un regard inquiet et lucide, une question traverse les esprits de la diaspora et des militants de la souveraineté haïtienne : si le Niger, le Burkina Faso, le Mali semblent se réveiller et prendre leur destin en main, pourquoi Haïti reste-t-elle clouée au sol, encore prise dans les filets de l’ingérence étrangère et des trahisons internes ?
Un vent d’insoumission souffle sur l’Afrique de l’Ouest. Ces derniers mois, les capitales de Bamako, Ouagadougou et Niamey ont vu monter une fièvre populaire, une soif de rupture. Les juntes militaires, souvent mal perçues ailleurs, ont trouvé dans ces pays un écho inattendu : celui d’un peuple qui dit non, sans détour, à la domination étrangère. France, Union européenne, États-Unis… ces puissances, autrefois omniprésentes dans les affaires internes de ces pays, voient désormais leurs représentants expulsés, leurs bases démantelées, leur influence contestée.
Le Mali fut le premier à tirer le frein d’urgence. En 2021, après des années de lutte contre les groupes armés et l’échec patent de l’opération Barkhane, la population malienne a fini par voir dans la présence française non pas une solution, mais un problème. En quelques mois, les militaires prennent le pouvoir, dénoncent les accords avec Paris, se tournent vers d’autres partenaires – notamment la Russie – et tentent de reprendre le contrôle de leur souveraineté.
Le Burkina Faso suit rapidement. Lassés par l’insécurité et la misère persistante malgré les promesses de coopération occidentale, les Burkinabè réclament le départ des troupes françaises, puis l’obtiennent. Le Niger, en 2023, rejoint ce mouvement, malgré les pressions et sanctions économiques. Les symboles tombent : drapeaux, statues, bases militaires. Ce ne sont pas que des gestes : ce sont des actes fondateurs, les signes d’un tournant historique.
Mais pendant que ces pays africains essaient – souvent à marche forcée – de reprendre la main sur leur avenir, Haïti, elle, semble figée.
Le berceau de la première république noire libre du monde, celle qui a défié Napoléon et aboli l’esclavage à la pointe de la machette, semble aujourd’hui prisonnière de chaînes plus subtiles, mais tout aussi oppressantes. Les institutions haïtiennes sont laminées. Le pays vit sans président légitime, sous l’œil d’une communauté internationale qui oscille entre désintérêt et interventionnisme cynique.
L’ONU revient. Encore. Une nouvelle mission de sécurité, cette fois menée par le Kenya, validée par les États-Unis, est en route pour tenter de “stabiliser” Port-au-Prince, en proie à une explosion de la violence des gangs. Officiellement, il s’agit d’aider. En réalité, beaucoup d’Haïtiens y voient un nouveau chapitre d’un scénario désormais bien connu : une mainmise étrangère sur les leviers du pouvoir, des décisions prises sans consultation populaire, et une élite politique corrompue qui pactise avec ses sauveurs pour mieux trahir son peuple.
La question est donc inévitable : pourquoi Haïti n’arrive-t-elle pas à rompre ce cycle ? Pourquoi l’élan de souveraineté qui secoue l’Afrique ne trouve-t-il pas d’écho dans les rues de Port-au-Prince ou de Cap-Haïtien ?
D’abord, il faut le dire : la situation est plus complexe qu’il n’y paraît. Contrairement aux pays africains qui disposent d’un appareil militaire (aussi imparfait soit-il), Haïti n’a plus d’armée depuis 1995. Elle est sans défense réelle, livrée à des bandes armées qui tiennent désormais une grande partie du territoire. Les anciens “chefs” sont devenus des seigneurs de guerre. Et les autorités légitimes ? Trop souvent compromises, discréditées ou manipulées depuis l’étranger.
Ensuite, Haïti paie le prix d’une trahison historique. De l’intérieur. Depuis plus de 30 ans, des dirigeants haïtiens ont vendu leur loyauté au plus offrant. Prêts à signer n’importe quel accord en échange d’une aide, d’un visa, d’un poste à l’international, ils ont vidé la République de sa substance. Les pires ennemis de l’indépendance haïtienne ne portent pas toujours un passeport étranger – certains sont nés à Port-au-Prince, Jacmel ou Gonaïves.
Et pourtant… l’espoir n’est pas mort. Une jeunesse lucide, déconnectée des partis traditionnels, commence à émerger. Dans les quartiers populaires, dans les réseaux sociaux, dans les diasporas, des voix s’élèvent. Elles rappellent Toussaint Louverture, Dessalines, Catherine Flon. Elles demandent une réécriture du contrat social. Une réforme de fond, pas imposée depuis Washington ou Paris, mais élaborée par et pour le peuple haïtien.
Alors, Haïti peut-elle, elle aussi, se relever ? Oui, si elle ose affronter ses fantômes. Si elle cesse de croire aux sauveurs extérieurs. Si elle désarme les traîtres nationaux – politiquement, moralement, juridiquement. Si elle rebâtit une souveraineté, pierre par pierre, dans le chaos même.
Le réveil africain montre que c’est possible. Difficile, imparfait, incertain… mais possible. À Haïti maintenant de décider si elle veut rester une colonie honteuse du XXIe siècle ou redevenir une nation debout.